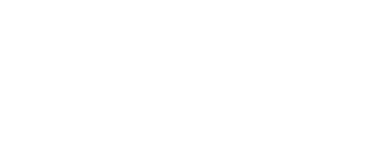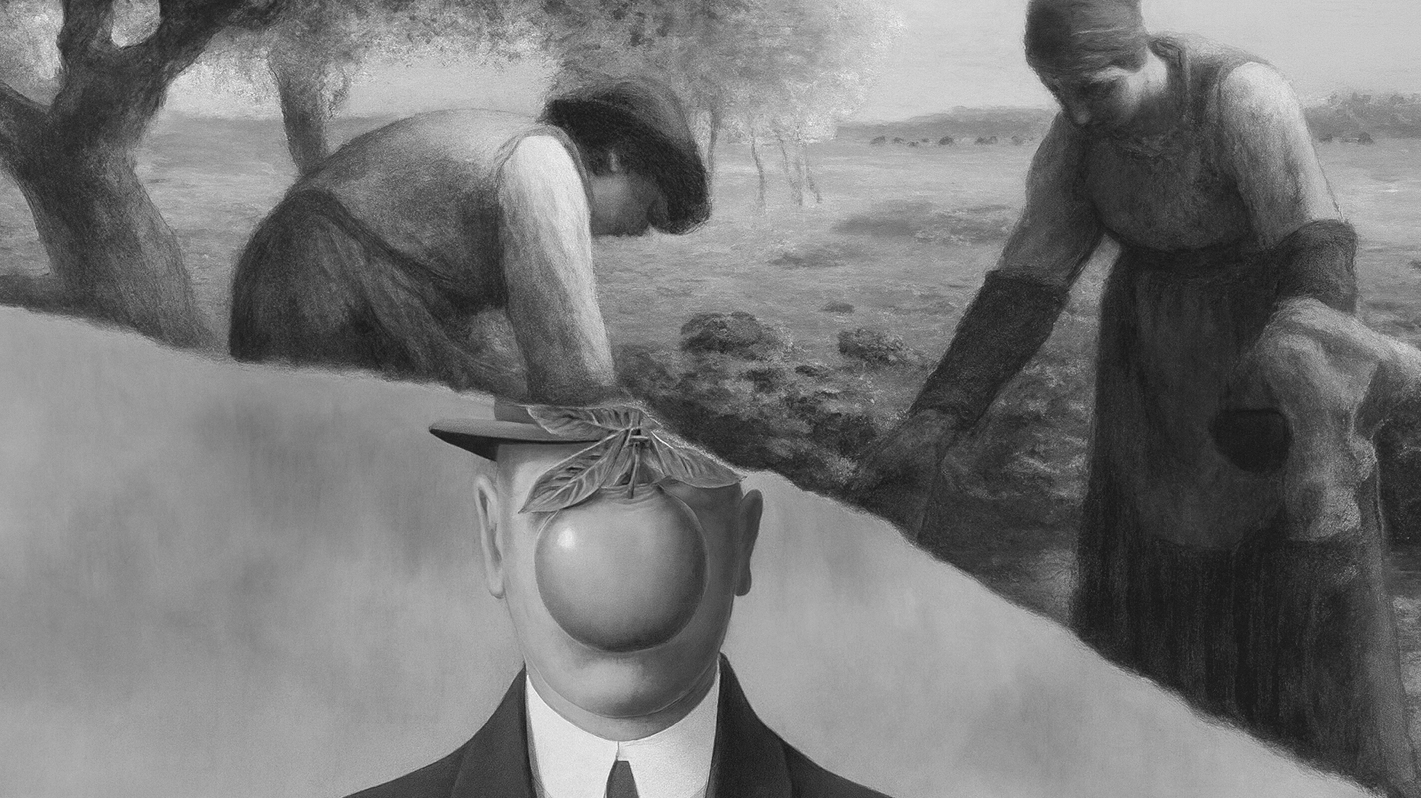Dans notre article précédent, « 6 femmes artistes qui ont changé l’histoire de l’art pour toujours », nous avons mentionné comment les projecteurs de l’histoire de l’art ont souvent été braqués sur les hommes, même si de nombreuses femmes ont façonné de manière puissante et permanente le cours de l’art.
Dans l'article d'aujourd'hui, nous mettons en lumière six autres femmes artistes qui ont contribué à façonner l'histoire de l'art. Des salons impressionnistes aux installations conceptuelles, leurs noms ne figurent peut-être pas dans tous les manuels, mais leur influence est indéniable. Ces femmes artistes méconnues méritent d'être commémorées, étudiées et célébrées.
Berthe Morisot : L'œil féminin de l'impressionnisme
Nous commençons par Berthe Morisot, née en 1841 à Paris. C'était une peintre dont le nom est peut-être moins connu, même si elle a contribué à façonner l'un des mouvements artistiques les plus influents de l'histoire.
Morisot fut l'une des fondatrices du mouvement impressionniste et la seule femme du groupe initial. En 1874, lorsqu'un cercle d'artistes se sépara du Salon officiel pour organiser sa propre exposition indépendante, elle en fit partie. Elle participa ensuite à sept des huit expositions impressionnistes, soit plus que Monet lui-même.
Mais l'univers de Morisot était différent. Alors que nombre de ses pairs masculins peignaient des rues animées ou des paysages grandioses, elle se tournait vers l'intérieur, vers les intérieurs paisibles, la vie de famille et les moments intimes du quotidien. Non pas par manque d'imagination, mais parce que le monde public était souvent fermé aux femmes à l'époque.
Ces limites ne limitaient pas son art. Elles le façonnaient. Son coup de pinceau était délicat mais assuré. Ses couleurs resplendissaient de lumière. Il y a de la douceur dans ses peintures, mais jamais de passivité. Seulement une compréhension profonde et réfléchie de la présence et du temps.
De son vivant, les critiques ont souvent qualifié son œuvre de « féminine » ou « intime », des termes qui, à l'époque, étaient utilisés pour la dénigrer plutôt que pour la louer. Aujourd'hui, nous les comprenons différemment.
Morisot n'a pas résisté au monde dans lequel elle vivait. Elle l'a transformé. Elle a fait de la vie domestique quelque chose de poétique et de significatif. Son tableau Le Berceau, par exemple, montre une femme veillant sur un enfant endormi. C'est un moment de calme, mais empreint de tendresse, d'atmosphère et d'une douce conscience du temps.
Entre ses mains, le quotidien s'illuminait. Par sa présence, sa sensibilité et le jeu subtil de la lumière, Morisot révélait la beauté des instants les plus calmes de la vie.
Sophie Taeuber-Arp : la femme qui a fait danser la géométrie
Sophie Taeuber-Arp est née en 1889 en Suisse et reste l’une des artistes les plus polyvalentes et visionnaires du XXe siècle.
Bien avant que Kandinsky ne devienne célèbre pour ses compositions abstraites, elle brodait déjà des motifs géométriques à la main. En 1918, elle créa des marionnettes d'une modernité saisissante, mi-robot, mi-jouet. Elle croyait que la beauté devait résider dans les objets que nous utilisons au quotidien.
Peintre, danseuse, sculptrice, créatrice textile et enseignante, sa créativité évoluait librement entre les disciplines. Là où d'autres voyaient des limites, elle voyait des possibilités. Elle poursuivait un seul objectif : créer de belles choses avec clarté et précision.
Alors que de nombreux artistes choisissaient un seul médium, elle les a tous adoptés.
Elle a réalisé des broderies et des peintures, sculpté des sculptures, édité des magazines, créé des marionnettes et construit des objets Dada énigmatiques.
Taeuber-Arp a commencé à explorer l'abstraction géométrique dès 1915, bien avant qu'elle ne soit largement acceptée en Europe. Elle a fusionné l'artisanat traditionnel avec l'abstraction moderniste, remettant en question la distinction entre art et design. Ses œuvres présentaient souvent des cercles, des carrés et des lignes rythmiques, non pas comme des éléments décoratifs, mais comme des formes vivantes. Ces formes apparaissaient dans les textiles, les marionnettes, les intérieurs et les objets du quotidien.
Entre ses mains, l’abstraction devient ludique, précise et profondément humaine.
Alors que le mouvement dadaïste zurichois embrassait le chaos et l'absurde, Taeuber-Arp apportait quelque chose de différent : un sens de la structure, de la clarté et du calme. Elle était l'une des rares femmes au cœur du mouvement dadaïste, et sa présence introduisait une nouvelle forme d'énergie alliant logique et imagination.
Plus tard dans sa carrière, elle travailla aux côtés de son mari Jean Arp et contribua à façonner le langage de l'abstraction moderne. Bien que souvent éclipsée par son nom, elle conserva une voix distincte et indépendante.
Aujourd'hui, elle est reconnue non seulement comme une artiste brillante, mais aussi comme une pionnière du design moderne. Elle ne se contentait pas de créer des formes, elle leur donnait vie. Elle donnait à la géométrie une dimension humaine.
Elle meurt subitement en 1943 à l’âge de 53 ans, mais son influence continue de croître.
Dans un monde qui séparait autrefois l’art de la vie quotidienne, Sophie Taeuber-Arp les a réunis, un cercle, un point, une étape à la fois.
Lee Krasner : une pionnière à part entière
En parlant d'expressionnisme abstrait, vous avez probablement entendu parler de Jackson Pollock. Mais qu'en est-il de Lee Krasner ?
Née en 1908 à Brooklyn, New York, Krasner devint l'une des voix les plus fortes et les plus inventives de l'expressionnisme abstrait américain. Pourtant, pendant une grande partie de sa vie, elle fut connue non pas pour son œuvre, mais pour avoir été l'épouse de Jackson Pollock.
On oublie souvent que Krasner était déjà une artiste reconnue avant même de le rencontrer. Elle a étudié à la Cooper Union, à la National Academy of Design, puis s'est formée auprès de l'influent peintre abstrait d'origine allemande Hans Hofmann.
Ses bases étaient solides. Elle comprenait le dessin classique, la structure cubiste et l'expérimentation moderniste. Mais elle ne se contentait jamais de se répéter. Tout au long de sa carrière, elle a constamment repoussé les limites.
Dans les années 1950, elle commence à créer de puissants collages. Elle découpe des dessins et des peintures antérieurs, puis réassemble les fragments pour former des compositions brutes et saisissantes. C'est un acte de réinvention, un refus de rester figée dans une identité ou une phase de son œuvre.
Après la mort de Pollock dans un accident de voiture en 1956, Krasner s'installa dans son atelier situé dans une grange à East Hampton. C'est là qu'elle commença à travailler à une échelle beaucoup plus grande.
Un tableau clé de cette période, faisant partie de ce qui deviendra sa série « Vert Terre », présente de larges coups de pinceau noirs superposés de touches de rose, de blanc cassé doux et de vert profond. Les formes évoquent le corps féminin et la vie végétale, des formes organiques liées aux cycles de croissance, de transformation et de deuil.
La perte n'a pas étouffé sa créativité. Elle l'a au contraire approfondie.
Krasner a dit un jour : « J'étais une femme, juive, veuve, et une sacrée bonne peintre. Il fallait que je prouve tout cela. »
Aujourd'hui, nous la voyons non pas comme une artiste dans l'ombre, mais comme une figure majeure de l'art américain d'après-guerre. Elle est restée attachée à l'expérimentation, changeant constamment de technique, d'approche et d'échelle. Sa persévérance a ouvert la voie au courage et aux possibilités pour des générations de femmes artistes.
Leonora Carrington : la surréaliste qui refusait d'être une muse
Leonora Carrington est née en Angleterre en 1917 dans une famille aisée mais stricte. On attendait d'elle une femme respectable. Elle a choisi autre chose : la sauvagerie plutôt que l'obéissance, la liberté plutôt que la formalité.
Au début de la vingtaine, elle s'était enfuie avec le surréaliste allemand Max Ernst et avait pénétré au cœur de l'avant-garde européenne. Mais la vision surréaliste des femmes était complexe.
De nombreux artistes masculins ont adopté les idées freudiennes qui présentaient la psyché féminine comme mystérieuse et intuitive, idéalisée mais rarement respectée. Les femmes étaient souvent considérées comme des muses, et non comme des créatrices.
Carrington a refusé ce rôle. Comme elle l'a dit un jour : « Je n'avais pas le temps d'être la muse de qui que ce soit. J'étais trop occupée à me rebeller contre mes parents et à apprendre le métier d'artiste. »
Ses peintures se démarquaient. Elles mettaient en scène d'étranges créatures, des figures fantomatiques et des femmes se livrant à des rituels magiques. Carrington construisait un monde symbolique ancré dans la transformation et le sacré, non lié à une religion particulière, mais vivant dans les recoins silencieux de l'esprit.
Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et une période de bouleversements personnels, Carrington s'enfuit à Mexico, où elle vécut le reste de sa vie. Elle y trouva liberté créative et appartenance à une communauté. Avec Remedios Varo et Kati Horna, elle contribua à former un cercle rare de femmes surréalistes qui tracèrent leur propre voie.
Son œuvre est devenue encore plus complexe et symbolique. Elle a peint des corps hybrides, des espaces enchantés et des femmes telles des figures de force et de mystère. Elle croyait aux forces invisibles et ses toiles brillaient de présence.
Dans son dessin « Horloge de cuisine » de 1943, elle imagine la cuisine non seulement comme un espace domestique, mais aussi comme un lieu de transformation, où les femmes pratiquent l'alchimie quotidienne. Cette œuvre, petite et intime, reflète un surréalisme qui s'étend au-delà de Paris et des récits dominés par les hommes.
Aujourd'hui, Carrington est considérée non seulement comme une surréaliste, mais aussi comme une visionnaire qui a redéfini le subconscient à sa manière. Elle n'expliquait jamais ses visions. Elle nous invitait simplement à y entrer.
Chiharu Shiota : tisser la mémoire dans l'espace
Tournons-nous vers Chiharu Shiota, une artiste japonaise connue pour ses performances et installations puissantes qui donnent forme à des expériences intangibles telles que la mémoire, l’anxiété, les rêves et le silence.
Née à Osaka en 1972, Shiota a d'abord suivi une formation de peintre. Mais très tôt dans sa carrière, elle a senti que la peinture ne suffisait pas. Elle souhaitait que son œuvre occupe l'espace, entoure les gens et vive dans le corps autant que dans l'œil.
Elle est surtout connue pour ses installations immersives de fils. Des fils noirs, rouges ou blancs s'étendent à travers les pièces telles des toiles emmêlées, s'enroulant autour d'objets du quotidien comme des clés, des valises, des chaussures ou des lits d'hôpital. L'effet est envoûtant et profondément personnel, comme si le souvenir lui-même prenait forme et emplissait la pièce.
Dans les cultures d'Asie de l'Est, le fil rouge symbolise souvent le destin ou les liens humains. Shiota l'utilise pour explorer l'absence, le désir et les liens invisibles entre les êtres. Ses installations ne représentent pas la mémoire. Elles nous permettent de la traverser.
Une grande partie de son art est façonnée par son expérience personnelle. Étudiante en Allemagne, elle a lutté contre sa propre identité et le sentiment d'être loin de chez elle. Plus tard, une grave maladie l'a amenée à réfléchir à la vie, à la mort et à ce qui reste après notre départ.
Ses installations brouillent la frontière entre rêve et mémoire. Leur silence invite à la réflexion, tandis que leur ampleur suscite l'émerveillement.
On se souvient de l'histoire du philosophe chinois Zhuangzi, dans laquelle un homme rêve qu'il est un papillon, puis se demande s'il est désormais un papillon en rêvant qu'il est un homme. Cette même incertitude transparaît dans son ouvrage de 2018, Butterfly Dream.
Le processus de Shiota est physique. Elle et son équipe passent des jours, voire des semaines, à tisser des milliers de fils à la main. Il y a du travail, de l'immobilité aussi, et une sorte de rituel.
Elle a dit un jour : « La mémoire est quelque chose que nous ne pouvons ni toucher ni voir, mais elle est très forte. »
Comme la mémoire, son œuvre est silencieuse mais persistante. Elle nous invite à nous arrêter, à respirer et à ressentir l'indicible.
Yoko Ono : une pionnière de l'art conceptuel et participatif
Nous terminons avec Yoko Ono, une artiste, musicienne et activiste japonaise qui remet en question la façon dont nous définissons l’art depuis plus d’un demi-siècle.
Née à Tokyo en 1933, Ono s'installe aux États-Unis dans les années 1950 et devient une figure incontournable de la scène avant-gardiste new-yorkaise. Elle est l'une des rares femmes étroitement impliquées dans le mouvement Fluxus, qui rejette les objets d'art traditionnels au profit des idées, des actions et des expériences.
Les premières œuvres d'Ono brouillaient la frontière entre l'art et la vie. Nombre de ses premières œuvres s'appuyaient sur des instructions, données verbalement ou par écrit. Dans « Peinture sur laquelle on peut marcher », elle posait une toile au sol et invitait les spectateurs à la traverser, physiquement ou mentalement. Un geste discret mais radical qui abolissait la frontière entre l'art et le quotidien.
Son travail ne consiste pas à fabriquer des objets. Il invite le public à imaginer, à participer et à devenir partie prenante de l'œuvre elle-même. Dans Cut Piece, elle restait assise en silence sur scène tandis que le public découpait des morceaux de ses vêtements. L'acte, simple mais profondément provocateur, soulevait des questions urgentes sur la vulnérabilité, le pouvoir et le regard porté sur le corps des femmes.
Tout au long de sa carrière, Ono a utilisé des matériaux simples pour explorer des idées complexes : la paix, le deuil, le féminisme, l’intimité et la connexion. Dans Wish Tree, une série qu’elle a commencée dans les années 1990, les visiteurs écrivent leurs vœux sur du papier et les attachent aux branches d’un arbre. Chaque note s’inscrit dans un champ grandissant d’espoir partagé.
Bien qu'elle soit souvent reconnue pour sa relation avec John Lennon, l'héritage artistique d'Ono est unique. Bien avant et bien après ce chapitre, elle a créé des œuvres qui remettaient en question les systèmes, brisaient les barrières et ouvraient un espace émotionnel.
Sa pratique a évolué aux côtés d'artistes comme John Cage et Nam June Paik, qui pensaient que l'art ne devait pas nécessairement résider dans une galerie. Il pouvait s'agir d'une idée, d'un son, d'une pensée échangée entre des inconnus.
Son travail est conceptuel, mais jamais froid. Il invite à l'introspection. À l'écoute. À imaginer une autre façon d'être.
Comme l'a dit un jour Yoko Ono, « Un rêve que vous rêvez seul peut être un rêve, mais un rêve que deux personnes rêvent ensemble est une réalité. "
Son travail nous invite à partager ce rêve, à devenir non seulement des spectateurs mais des participants de quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
Voir plus d’articles sur l'art
• 6 mouvements d'art moderne oubliés que vous devriez connaître
• Le surréalisme dans l'art : du rêve inconscient à la réalité artistique
• Signification de l’art contemporain : pourquoi est-il important dans le monde d’aujourd’hui ?
• L'impressionnisme : l'art de capturer des moments fugaces
↪ Suivez-nous pour plus de mises à jour : YouTube | Instagram